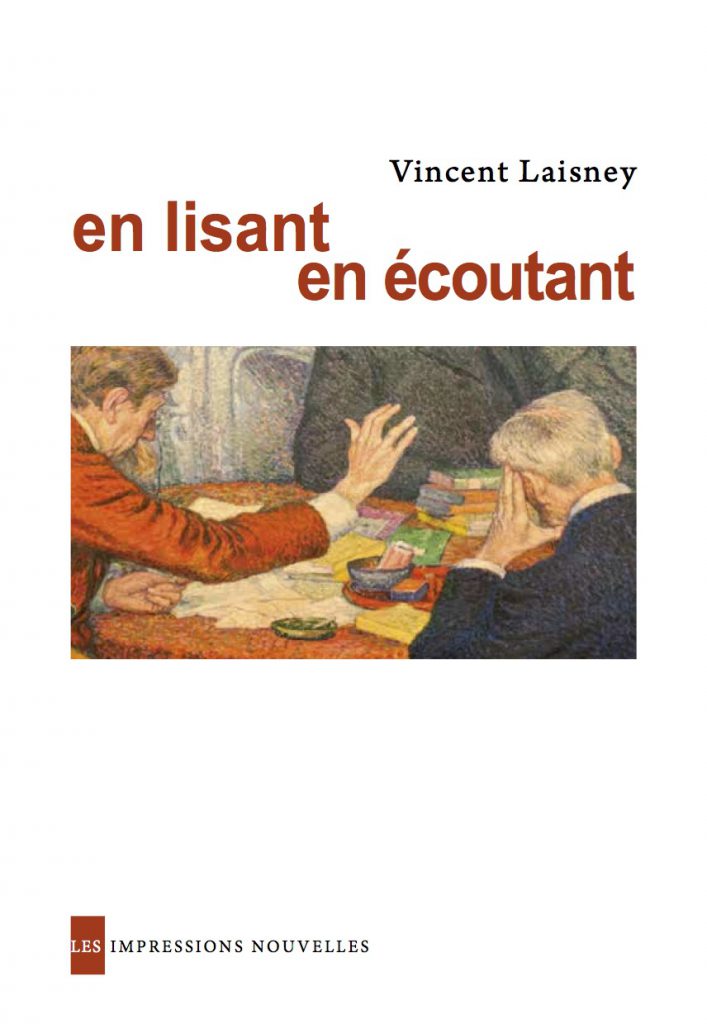Catégorie(s): Littérature
Genre(s) : Essai, Livre illustré, théorie littéraire
ISBN : 978-2-87449-445-1
Format : 14,5 x 21 cm
Pagination : 224 pages
Prix : 17 €
Parution : février 2017
Cet ouvrage s’intéresse à un phénomène capital, quoique méconnu, de l’histoire littéraire du XIXe siècle : la lecture à haute voix en petit comité. De Lamartine à Gide en passant par Stendhal, Hugo, Flaubert, Rimbaud et Mallarmé, tous les écrivains ont essayé leurs œuvres devant un petit parterre d’amis et de confrères. Maillon oublié de la chaîne du livre, cette phase test est une étape importante, voire déterminante, dans le processus de création littéraire. Un tableau de Théo van Rysselberghe intitulé Une Lecture (1903) forme le point de départ de l’enquête.
Pourquoi lit-on ? Que lit-on? Pour qui lit-on ? L’auteur s’efforce de répondre à toutes ces questions en puisant dans une documentation variée (correspondances, journaux intimes, souvenirs littéraires, articles périodiques, etc.).
Érudit, l’ouvrage n’a pourtant rien d’académique. Il se présente sous la forme de 80 petits chapitres qui sont autant de pièces du puzzle de la lecture. Une fois n’est pas coutume, l’auteur raconte son enquête en même temps qu’il la mène. Chapitre après chapitre, le lecteur partage ses tâtonnements, ses découvertes, ses échecs – sa satisfaction enfin, quand le phénomène de la lecture littéraire en petit comité est redevenu visible.
Revue de presse
Diacritik
« Au XIXe, siècle de l’imprimé, la lecture en petit cénacle d’une œuvre littéraire fut néanmoins pratique courante. Dispositif fusionnel ou prétexte à exaspérer les jalousies et rivalités entre auteurs ? L’un et l’autre sans doute. Dans un petit ouvrage savoureux et savant, Vincent Laisney tente de nous dire ce que furent ces séances nombreuses dont il fait l’histoire en tant que forme de sociabilité et que genre oral. Et il le fait de façon allègre : au long des chapitres-vignettes qui forment son En lisant en écoutant, on ne s’ennuie vraiment pas. »
Jacques Dubois, Diacritik, 1er mars 2017
France Culture (Poésie et ainsi de suite)
Le Monde des Livres
Jean-Louis Jeannelle, Le Monde des Livres, 24 mars 2017
Nonfiction.fr
« Cette enquête demeure littéraire, elle renvoie à des œuvres, des écrits, des correspondances émanant des personnes plus ou moins intégrées à ces cénacles (il y a aussi les rejetés, mais ils y sont structurellement liés), ainsi qu’à des tableaux sur lesquels nous revenons ci-dessous. Elle intéressera les sociologues (appelés alors à étudier les « droits d’entrée » dans le champ littéraire), les historiens (cela complète un aspect de la sociabilité), les historiens de la littérature (qui oublient parfois les structures matérielles et sociales de la littérature), les créateurs (qui veulent prendre conscience des stratégies à conduire pour entrer dans un cénacle). Vincent Laisney présente son propos à partir d’une lecture pointilliste de tableaux du XIX° siècle dans lesquels il puise la possibilité de rendre compte de l’acte de lecture d’une œuvre (poétique ou romanesque) devant un cénacle destiné à la juger. Chateaubriand, Hugo, Mérimée, Delécluze, Beyle (alors connu sous le nom de Stendhal), Baudelaire, Flaubert, Mallarmé se sont pliés à cet exercice, essayant ainsi des œuvres devant un parterre d’amis ou d’auditeurs inconnus, fabricant dès lors leur réputation et ouvrant la voie à l’impression de l’écrit – parfois aussi à sa suspension momentanée, comme il en va de la Tentation de Flaubert – par la succession d’événements ainsi créés. Un tableau sert à la fois de déclencheur de la démarche et de point d’appui pour toute la démonstration. Il s’agit de celui de Rysselberghe – Une lecture, 1903 –, lequel intrigue d’abord l’auteur, puis lui permet de reconstruire un complément décisif de l’histoire littéraire, le phénomène de la lecture en public. »
Christian Ruby, Nonfiction.fr, 28 mars 2017
RTBF – Musiq3 (Les glaneurs)
Le livre de Vincent Laisney est chroniqué par Edgar Szoc dans l’émission de Fabrice Kada intitulée « Les glaneurs » consacrée à l’Histoire, les Hopis et les lectures en petit comité sur les ondes de Musiq3, le 30 mars 2017.
Le Matricule des Anges
Dans un long entretien avec Eric Dussert, Vincent Laisney revient sur les origines de la lecture à haute voix de textes littéraires en cours de création, avril 2017.
La Libre Belgique
Jacques Franck, La Libre Belgique, 3 avril 2017
Le Canard enchaîné
France Culture (La compagnie des auteurs)
Libération
Jean-Didier Wagneur, Libération, 22-23 avril 2017
Huffington Post
« La toile de Rysselberghe, qui évoque le rituel de la lecture à haute voix dans des cercles littéraires restreints, a suffisamment intéressé l’essayiste Vincent Laisney pour qu’il en fasse la source principale d’un passionnant ouvrage. Car, dans l’esprit de l’universitaire, cette scène est très représentative d’une forme de diffusion restreinte des œuvres littéraires, telle qu’elle s’est pratiquée de l’Empire jusqu’à la Grande Guerre. En fait, contrairement aux idées reçues, le développement de la presse et de l’édition au XIXe siècle n’a nullement mis un terme aux habitudes de littérature orale. Bien au contraire. Pour adapter son style à la facture du peintre, Vincent Laisney a lui-même adopté une esthétique pointilliste et a progressé dans son argumentation par petites touches. Il s’exprime à la première personne, comme un enquêteur qui connaît de notables réussites mais aussi des échecs au cours de ses investigations. »
Jeannine Hayat, Huffington Post, 9 mai 2017
La vie est un roman (Aligre FM 93.1)
Yves Tenret parle du vingt-troisième numéro de la revue Schnock consacré à Charles Aznavour et du XIXe siècle à travers deux livres: La Bande noire de Yves Meunier et En lisant en écoutant de Vincent Laisney, le 13 juin 2017, dans son émission littéraire « La vie est un roman ».
COnTEXTES
Jean-François Vernay, COnTEXTES, 16 octobre 2017
Studi Francesi
« Érudite mais jamais pesante, cette évocation au fil de 80 brefs chapitres a aussi le mérite d’aborder l’art de la diction et de nous inciter à écouter à nouveau la voix de Verhaeren ou d’Apollinaire enregistrée à l’initiative de F. Brunot, dans des circonstances hélas bien différentes du rite désormais archaïque d’une lecture réservée à quelques amis… »
Michel Arrous, Studi Francesi n° 185, mai/août 2018