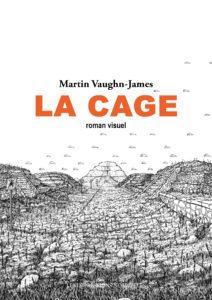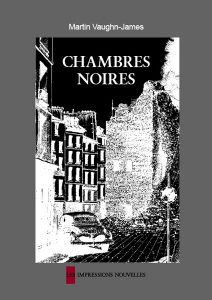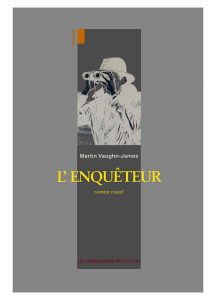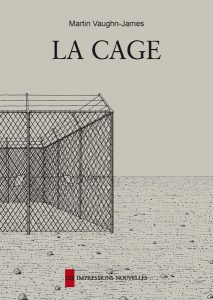De Benoît Peeters
Martin pour mémoire
12 septembre 2009
Faut-il la mort, vraiment, pour que nous comprenions à quel point nous aimions – à quel point nous aimons – ceux qui comptaient pour nous ? Faut-il la mort, vraiment, pour comprendre que nous les avons manqués, en les aimant mal, en ne sachant pas le leur dire ?
Je repense à Martin.
Longtemps, il ne fut pour moi que l’auteur d’extraordinaires séquences graphiques dans la revue Minuit. Ce devait être vers 1973, vous voyez ça d’ici. Dans Minuit, il y avait Beckett et Claude Simon, Robbe-Grillet et Deleuze et Guattari. Il y a même eu Mao Tse-Toung. Et il y avait quelques dessins. Robert Varlez, Michel Longuet. Et Martin, Martin Vaughn-James. Un drôle de nom, difficile à orthographier correctement. Plus difficile encore à prononcer. Dans Minuit, Martin apparut dès le numéro 2, avec « Le chien », et il devint bien vite indissociable de la revue. Il était le Nouveau Roman par l’image. Pas son illustrateur, mais celui qui le prolongeait, en des séquences narratives et brisées à la fois.
Pour quelques écrivains de ce temps-là, jeunes ou moins jeunes, Martin était le dessinateur ami, celui qui comprenait les textes et l’écriture. Ses images venaient naturellement prendre place dans les revues que nous aimions.
Je ne sais plus pourquoi au juste je les ai rencontrés pour la première fois, Sarah et lui, à la fin des années 70. L’étonnant est surtout de ne pas nous être croisés plus tôt. Je me souviens de leur appartement de la rue Monge, à deux pas de chez Claude Simon, comme d’une sorte d’immense volière. Des dizaines d’oiseaux volaient en liberté, sans la moindre cage. Peut-être est-ce ce jour-là, pourtant, que Martin m’a montré pour la première fois l’album The Cage, paru en 1975 à Toronto. Ébloui par la sûreté du dessin, par la puissance de ce labyrinthe narratif, je me suis aussitôt demandé pourquoi un tel livre n’existait pas en français.
Je travaillais alors, avec Marie-Françoise Plissart, dans une petite librairie bruxelloise appelée « Macondo ». Nous sommes parvenus à commander quelques exemplaires de The Cage au Canada. Nous les avons placés à côté de la caisse, nous en avons parlé à tous les proches, nous les avons vendus très vite. Bientôt, nous en avons redemandé un plein carton. Et quand nous avons créé les Impressions Nouvelles, au milieu des années 80, avec Marc Avelot et Jan Baetens, La Cage a fait partie de nos premières publications. Fonder une maison d’édition, entreprise difficile et dangereuse, c’était aussi, c’était d’abord, vouloir rendre visible un chef-d’œuvre comme La Cage.
Les années passent. Éternels nomades, Martin et Sarah s’étaient fixés en Normandie, pas bien loin de chez Flaubert. Mais Flaubert était mort et les hivers étaient glacés. Un jour, ils arrivèrent à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles ? Mais pourquoi pas, quand on est passé par Bristol, Sydney, Toronto, Paris et quelque trou normand ? Ils s’installèrent à Saint-Gilles, place Louis Morichar, juste en face de chez Marie-Françoise et Virginie.
Nous nous sommes vus plus souvent. Martin ne dessinait plus. Il peignait. Les galeries avaient remplacé les revues, mais son univers était toujours là, aussi dense, aussi prégnant, aussi intempestif. Bruxelles y prit de plus en plus de place.
Plusieurs années durant, Martin eut son atelier dans la maison que nous habitions, Sandrine Willems et moi, rue de la Source. De temps en temps, l’un de nous frappait à sa porte pour découvrir ses nouveaux tableaux.
Martin avait rencontré beaucoup de nos proches, et d’abord François Schuiten. Pour nous, il accepta de devenir Augustin Desombres, un artiste maudit de la fin du 19e siècle, hanté par des images d’un autre monde où il essayait de passer. Desombres s’imposa dans Les Cités obscures. Martin lui prêta ses traits et un peu plus que ses traits, à de multiples reprises. Entre les photos de Marie-Françoise, les planches de François, les tableaux de Martin, bien des motifs se sont croisés.
L’amitié ne fut pas toujours facile. La vie nous rapprochait, nous éloignait, nous nous heurtions quelquefois. Nous étions rudes, bourrus peut-être, chacun à notre façon. Mais me reviennent quelques moments magiques, comme le tournage du petit film sur la naissance d’un tableau, dans l’atelier de la rue de Livourne. Ou comme cette rencontre à Angoulême, lors de l’exposition des originaux de La Cage, où Martin put sentir à quel point ce livre avait fait son chemin, silencieusement, et était devenu quasi mythique.
Aujourd’hui encore, si nous fermons les yeux, si nous pensons à Martin, des images nous arrivent et se fixent, inoubliables. C’est le propre des grands artistes.
De Marc Avelot
La grandeur de Martin Vaughn-James
Hommage
Je dis : Martin Vaughn-James est « un grand peintre ».
Et je sens bien ce que cette affirmation peut avoir de problématique. Deux fois, au moins, par l’office de chacun de ses termes : « peintre » d’une part, « grand » de l’autre.
Comment, en effet, assigner à la seule peinture un artiste pour qui le dessin fut si central, si déterminant ? Bien sûr, une périodisation pourrait venir à la rescousse, la dynamique de l’œuvre, sa chronologie même qui d’un « presque tout dessin » fait passer à « presque tout peinture ». Apparemment. Apparemment, car il ne peut échapper au connaisseur qu’il y a tout un temps où les deux pratiques coexistent, se chevauchent, dialoguent ; il ne peut non plus lui échapper que la peinture plusieurs fois s’incorpore des dessins, les marouflent ; il ne peut pas, enfin, ne pas s’arrêter au fait qu’en pleine période picturale, il produit un roman graphique.
Si cette amphibologie du dessin et de la peinture est une des caractéristiques de l’œuvre de Martin Vaughn-James, c’est que ce dernier porte finalement assez peu d’intérêt au lieu commun que forme l’opposition académique de la peinture et du dessin.
Ce n’est pas son problème.
Son problème, si je puis le dire, nous en parlions quelquefois, c’est la représentation, un problème au regard duquel le dessin et la peinture constituent deux voies d’explorations spécifiques, chacune avec ses difficultés, chacune avec sa méthode.
Je crois en effet que pour comprendre ce qui mobilise le désir du peintre Vaughn-James, saisir ce qui lui confère cette hargne si singulière, son infatiguabilité artistique, pour comprendre cela, dis-je, il faut s’être averti du vertige qu’engendrent les problèmes de la représentation quand on affronte, comme il l’a fait, c’est-à-dire sans concession, la question du synchronique et du diachronique.
Ces problèmes sont inversés selon qu’on est peintre ou qu’on est écrivain :
– pour l’écrivain, c’est la description qui est redoutable – cet exercice qui a pour tâche scabreuse de convertir un plan en une ligne, une synchronie en diachronie.
– pour le peintre, c’est la narration qui est périlleuse – cette gageure de mettre en plan une succession, d’inscrire une diachronie dans une synchronie.
Ce n’est ici ni le lieu ni le moment de détailler les innombrables difficultés que fait structuralement naître cette adversité du synchronique et du diachronique, ni les subtiles et byzantines solutions que les artistes y apportent. Il suffit aujourd’hui de souligner qu’à l’inverse de toute une tradition qui tentait de résorber le problème en intimant à chaque médium l’ordre de s’approprier par affinité un seul champ opératoire (le synchronique à la peinture, le diachronique à l’écriture), Martin Vaughn-James s’engage très tôt dans un combat à front renversé et cela en mettant au cœur de ses préoccupations le récit.
C’est en ce sens précis – qu’il se pose des problèmes d’écriture picturale, d’écriture par la peinture – que Martin Vaughn-James peut dire, comme on l’a entendu tout à l’heure dans le film de Benoît Peeters, « je suis un peu littéraire ». Loin d’un simple problème d’influence, d’une vague coïncidence historique, l’intérêt que Martin Vaughn-James porte au Nouveau Roman et, très précisément à Claude Simon, tout de même que sa collaboration avec la revue Minuit, procèdent d’une véritable communauté de souci et de travail.
En passant du dessin à la peinture, on peut mieux le saisir à présent, Martin Vaughn-James ne fait d’abord que poursuivre sa guerre par d’autres moyens. En bon stratège, il inverse l’attaque : quand, avec le dessin, il déploie graphiquement le récit, le met, dans tous les sens, « en procès » (c’est-à-dire simultanément en marche et en cause), avec la peinture, il concentre le récit, le virtualise. En un mot, dessiné, le récit joue de son évolution, peint, il joue de son involution.
Le passage à la peinture, c’est peut-être d’abord cela chez Martin Vaughn-James : la conscience plus ou moins claire, plus ou moins formulée, plus ou moins légitime, que, dans le champ du dessin, il a proprement exténué sa problématique, qu’après le chef d’œuvre que sont La Cage et L’Enquêteur, il ne peut guère aller plus loin sans se répéter. Si l’on suit d’un peu près ce « passage à la peinture » – comme on parle d’un « passage à l’acte » –, on peut discerner qu’il n’est pas brusque, qu’il ménage des degrés comme autant de « progrès » du peintre Vaughn-James. Ces progrès ne se mesurent pas en qualité technique – même si on voit que l’artiste maîtrise de mieux en mieux sa technique – ils se mesurent en approfondissement des problèmes picturaux. Comme toujours, les solutions du début sont radicales, on se porte à l’extrême. Les représentés des premières toiles sont exhibitoirement narratives : je veux dire que leur « sujet » est stéréotypiquement conducteur de récit : la guerre, le voyage et, chus là, tous les débris de désastres obscurs.
Puis adviennent les tableaux-photos. Ce que ces toiles offrent au regard, ce ne sont plus des sujets mais des « scènes » – parfois seulement deux, quelquefois quatre ou davantage –, et qui sont comme insérées dans la représentation dominante du tableau qui leur sert de « caisse de résonnance ». C’est que ces « incrustations » sont entre elles, et par rapport au tableau souche, dans une relation d’affinité, qu’elles se font écho : une jetée en feu et une famille à la plage, un jardin et trois clichés de mariage, un groupe d’hommes avec une femme vêtue de blanc et un paquebot…
Un rapport semble chaque fois exister mais il est systématiquement incertain et c’est dans le champ imaginaire ouvert par cette incertitude que s’infiltre le récit, faisant chaque fois du spectateur un « enquêteur » : quelle histoire lie la famille à l’incendie ? Un de ses membres y a-t-il péri ? Le jardin a-t-il été le cadre d’une idylle, appartient-il au couple ? mais que fait aussi ce chien que son traitement pictural rapproche des mariés cependant que sa place dans la composition le lie au jardin ? Cette femme vêtue de blanc et dont les pieds menus semblent se protéger de la menace des hommes en noir, a-t-elle voyagé sur ce paquebot ? Y est-elle montée volontairement ou l’y a-t-on forcée ? Une multitude de récits hypothétiques se forme au gré desquels le fantasme « prend » comme on le dit d’un ciment. La toile capture son contemplateur ou plutôt elle le captive tout en le laissant narrativement libre. Bonheur de Martin Vaughn-James : on ne se raconte jamais les mêmes récits.
Il y a ainsi une modernité fondamentale chez Martin Vaughn-James, d’autant plus forte qu’elle ne s’affiche pas, qu’elle semble même se cacher derrière une facture classique, esthétisante. Moderne, l’œuvre de Martin Vaughn-James l’est notamment par le soupçon, cette inquiétude que, par toutes ses voies et par tous ses chemins, elle insinue constamment dans la représentation ; moderne elle l’est aussi par la place qu’elle donne au scrutateur : celle d’un co-auteur dans une forme entièrement originale de work in progress où les personnages sont proprement dévisagés, facilitant ainsi l’identification fantasmatique.
C’est assez dire combien Martin Vaughn-James est « un grand peintre ».
Mais si Martin Vaughn-James peut être dit « un grand peintre », ce n’est pas seulement en raison de l’importance des questions picturales qu’il traite, ni même à cause de son étrange modernité, de la beauté formelle de ses tableaux et de leur élégance (il faudra un jour expliquer ce qu’est l’élégance d’un tableau, et qui n’est pas sa beauté). S’il peut être dit « grand », c’est aussi et surtout parce que l’engagement de toute sa pratique et de sa vie même a affaire avec la « grandeur ».
Qu’est-ce que la grandeur ?
Je n’en dirai ici que trois mots.
C’est, pour une part, une certaine élévation dans les buts qu’on s’assigne. C’est, pour une autre part, la hauteur à laquelle on place ses critères de satisfaction. C’est, enfin, l’altitude des modèles qu’on se donne. Tout ensemble, c’est la manière dont un être vit sa vie sous les espèces d’une destinée.
Ceux qui ont connu Martin Vaughn-James savent de quoi je parle.
Cette grandeur ne met pas à l’abri du ridicule, ni ne protège contre la souffrance, elle peut seulement nous épargner, non la misère mais le misérable.
Comme elle consiste autant dans ce qu’elle retient de faire que dans ce qu’elle commande d’accomplir, cette grandeur n’a pas besoin d’œuvre : un rêve d’œuvre peut suffire.
Mais si, comme chez Martin Vaughn-James, l’œuvre est là et qu’en quelques occurrences elle est parvenue à égaler le rêve, que faut-il pour que la grandeur subjective devienne une grandeur objective, pour que ce que quelques-uns pensent de Martin Vaughn-James beaucoup d’autres l’estiment aussi ?
Il y faut ce que l’on appelle communément la reconnaissance.
Ses voies, selon les arts, ne sont pas les mêmes et beaucoup, pareillement celles de Dieu, sont impénétrables.
S’agissant de peinture, on peut toutefois en cerner quelques-unes : la reconnaissance par les collectionneurs, par les marchands, par les pairs, par les institutions.
C’est dire qu’il nous appartient à tous et à chacun, solitairement ou solidairement, que Martin Vaughn-James devienne ce qu’il est : un grand peintre.
De Christian Rullier
Voici, réécrit de mémoire, à partir de quelques bribes rédigées au crayon blanc sur un carnet noir retrouvé, l’un des textes que j’ai dû écrire vers le début des années 80, alors que Martin Vaughn-James et moi-même envisagions une collaboration pour un livre de textes et d’images. À l’époque, le concept de “roman visuel“ était peu développé, je crois, et mon désir, à vrai dire, était informulable. Je commençais tout juste à écrire pour quelques revues que j’aimais alors, des laboratoires d’écriture où je me sentais à ma place, où il se passait quelque chose de vivant, d’insolite, comme la revue Minuit.
“Il y a beaucoup de choses que je ne regarde pas, où je suis seulement là, comme une odeur chaude de caoutchouc sur le pistil d’une fleur, je distingue des silhouettes, ça parle, j’entends des mots, ça fait une curieuse musique qui m’évoque des images, des couleurs, des sarabandes de lieux qui s’enchaînent, se chevauchent, se superposent, sans logique apparente pour les gens qui y vivent, qui se sont dits un jour Oui, c’est là que je vis, c’est là que je veux aimer, c’est là que mon corps cessera de bouger. Parfois, dans mon lit, ces choses-là vont très vite, comme pour échapper au sommeil, elles s’articulent en des structures complexes que j’essaie de comprendre jusqu’au petit matin, jusqu’au café au lait que quelqu’un me présente, avec une grosse tartine de pain de seigle, c’est sans doute ma grand-mère qui l’a confectionnée, elle aime trancher le pain en biseau, appuyé contre sa poitrine, la blouse couverte de cette poudre dorée que je prends parfois pour du sang. Le ton est doux, je fais oui de la tête, je mange et je vois des algues, ma langue les chahute d’une gencive à l’autre, elles s’enfoncent une à une, lambeau après lambeau, dans le siphon profond, où je devine leur décomposition comme si j’en étais à la fois la victime et la cause, cela me fatigue beaucoup, d’autant qu’en ouvrant la bouche, en mordant de plus belle, je mets en route un nouveau cycle avec des images nouvelles qui ressemblent un peu aux anciennes, mais ne sont plus tout à fait les mêmes, les décors ont changé, le temps aussi sans doute, comment savoir, alors que le café au lait les efface, vraies ou fausses, sur le sable doré du gosier qui me brûle.
Ce matin, je suis malade. Le docteur a dit ça. Malade et contagieux. Rester au lit, une fois encore. Et personne n’a dit Non. Le docteur n’aime pas être contrarié, il sent mauvais, un tissu imbibé qui aurait séché dehors, pas très loin d’une étable. On a parlé de fièvre, fait le tour des épidémies, avec des noms bizarres comme des fleurs exotiques, je me sentais important avec des noms pareils. Ce n’est rien, a dit le docteur, c’est un sourire de fièvre. C’est comme ça que j’ai pu comprendre que la fierté et la température avaient un point commun, un petit sourire indicible, j’ai pensé que ça pourrait m’aider dans la vie de savoir une chose comme celle-ci, que j’avais bien de la chance de pouvoir apprendre dans mon lit, sans avoir à enfiler cette blouse bleue que je n’aime pas pour aller recopier des prières sur le vieux tableau noir, où plein d’autres derrière s’entremêlent, mal effacées. Et cette poudre de craie sur les doigts, qui elle aussi, parfois, sous les vitraux de la chapelle, a des reflets de sang.”
Les éditions de Minuit, pour moi, c’était tous ces textes immenses – Butor, Pinget, Beckett, Simon, Sarraute, et Ricardou, entre autres – qu’un auteur à lui seul, comme un séduisant corsaire, un rebelle à l’intelligence redoutable, armé d’une étoile bleue, lançait en maître absolu à l’assaut de la littérature bourgeoise : Alain Robbe-Grillet, l’irremplaçable. Mais les éditions de Minuit, l’image que j’en avais, c’était aussi ces “petits dessins“ qui, pendant plusieurs années, ont donné aux couvertures de la revue la valeur visuelle d’un mystère et toute l’étendue d’une étrangeté familière. Ces dessins, point après point, étaient alors comme des cristaux de sens, comme si le Nouveau Roman tout entier et quelques autres textes qui ne s’écriraient jamais avaient un jour franchi la frontière de l’image et s’y étaient en quelque sorte cristallisés, formant ces matériaux visuels à clés, dont aucune porte, pourtant si précise, ne donnerait jamais sur une illusion de réel apaisante. Les dessins de Martin ont l’élégance et la générosité, la cruauté aussi – mais cela n’a jamais été incompatible ! – de nous montrer l’ambivalence de nos perceptions, de nos attentes, de nos errances, le trouble de nos désirs que l’on croit perspectives et qui, souvent, ne sont que des miroirs ou des reproductions de rêves, qui parfois ne nous appartiennent pas, comme dans la vie en somme, comme dans la littérature de Borges. Tout objet, dès lors qu’il se dessine, y apporte la trame ou la trace d’une énigme. Il porte le souvenir ou la prémonition. Tout y est en suspens, avec ce sentiment pourtant que tout est accompli, que sont rassemblées là les pièces qui précèdent ou qui suivent une action dramatique, dont les protagonistes sont déjà ailleurs, passés à autre chose. Certains sont encore dans l’image, peut-être, ou y sont revenus, silhouettes anonymes dans un geste immobile ou gros plans de visages dont on ne perçoit parfois qu’un fragment, tandis que d’autres nous regardent, nous observent, au centre ou à la limite de la page, comme pour plonger en nous et, en toute innocence, savoir ce qui est arrivé, ce qui peut advenir, si l’on se met un instant à leur place. Qu’avons-nous vu ? Que comprenons-nous à ce que nous voyons ? Nous sommes les spectateurs, les témoins, de toutes les choses que nous imaginons, et qui souvent ne tiennent qu’à un détail, un indice, à une fausse évidence dont nous seuls avons le secret dès lors que nous y projetons du sens. Les dessins de Martin nous enferment dans la logique d’une démarche policière, où des morceaux de rêve, des fragments de fantasme, nous conduisent sur des pistes laissées par nos instincts, faisant de nous des enquêteurs suspects, lancés tels des voyeurs aux trousses de nos ombres. Toutes les lectures de l’œuvre sont possibles, bien sûr, comme dans le surréalisme, comme dans le Nouveau Roman, l’analyse historique, philosophique, psychanalytique, matérialiste, et l’on en trouvera bien d’autres encore, mais la plus probante restera la nôtre, individuelle et universelle, celle qui joue avec nos connaissances, nos repères, celle qui, avec les aléas de notre construction, nous met au centre de l’énigme et lève un coin du voile, qui lui-même est peut-être un leurre, sur le sens de notre propre cage.
Trente ans ont passé maintenant depuis ma première rencontre avec Martin, mais nos rendez-vous au quartier Latin n’ont pas pris une ride. Il est là, avec ses joues creusées de grand oiseau inquiet, buvant une petite bière qui ne sera pas la dernière. Contrairement à bien des auteurs de l’écrit, il n’est pas venu pour parler de lui-même, il s’est assis pour connaître l’autre, pour savoir ce qu’il fait, ce qui le fait vivre, comprendre en quoi ses dessins ont pu susciter chez lui de l’intérêt, rencontrer ses préoccupations. Son écoute est totale, comme si les mots de l’autre, même parfois anodins, avaient une valeur que lui seul pouvait estimer. Dans des silences qui n’en sont pas, nous partageons de sourdes angoisses, qui se résolvent bientôt dans une exaltation à l’idée de ce qu’on va en faire, une image ou une phrase. Il y a aussi des rires, qui cachent de nouveaux nuages, de sombres inquiétudes. L’intranquillité est à notre table. Mais au bout d’une heure ou deux, il doit rentrer, sa femme l’attend, il doit faire quelques courses pour dîner.
La première fois que je suis entré chez Sarah McCoy et Martin Vaughn-James, ma surprise fut d’abord immense. Je connaissais quelques textes de Sarah, où je me sentais en terre familière, et bien sûr le travail de Martin, que j’imaginais solitaire et, pour dire vrai, produit dans une sorte de bunker sans lumière, à demi ensablé. Je ne peux décrire avec exactitude mon sentiment d’alors lorsqu’un petit oiseau est venu se poser sur ma main. J’entends encore les rires de Sarah et de Martin, et leurs quelques paroles échangées en anglais, mais j’étais trop éberlué par cette volière géante pour chercher à comprendre leurs clins d’œil malicieux. Nous étions entourés de petits oiseaux colorés, des oiseaux des îles, qui allaient et venaient à leur guise dans la vive clarté de ce salon bibliothèque, haut perché dans les étages, aux murs tapissés de filets pour protéger les livres. J’étais dans la stupeur, avec des images fausses, une fois encore, à gommer de mon imaginaire.
Le livre imaginé, finalement, ne s’est jamais fait. La vie avait à faire avec nous ailleurs, autrement, par d’autres chemins et avec d’autres gens. Il y eut une quinzaine de textes et une dizaine de dessins, je crois, dont un ou deux rejoignirent les couvertures emblématiques de la revue Minuit. En 1984, Martin fit un dessin pour la couverture de mon roman, “L’Alphabet des désirs“, qui devait paraître chez Buchet/Chastel, mais l’éditeur n’a pas voulu de cette image mystérieuse et inquiétante, car le marketing racoleur, dans le business des livres, était déjà à l’œuvre, et le respect des auteurs, au grand dam d’un Jérôme Lindon, devenait exception.
La suite de notre histoire se perd dans ma mémoire, peut-être s’arrête-t-elle là, à ce visage de femme, démesuré, dans l’entrebâillement d’une porte qui s’entrouvre sur une plage, ou quelque chose a dû se passer ou aura lieu peut-être en retournant la page ?
Aujourd’hui, ma tristesse est immense, bien au-delà de tous les mots que je pourrais écrire. Toutes mes pensées sincères vont à Sarah, et si je savais dessiner, saisir les mystères du sens de la vie, sans jamais les nommer, je lui enverrais une image de cette petite plage oubliée battue par la mousson violente, celle où je me trouve, ma plage, où des bateaux de bois, terrassés par le raz-de-marée, sont couchés sur le flanc, attendant qu’on leur donne une nouvelle histoire. Je ne sais pas laquelle, Martin doit avoir la réponse de l’autre côté de la Cage – est-elle la seule ? –, mais je sais que l’Amour et l’Art, en se transmettant, en se lovant dans le regard des autres, nous rendent plus vivants que jamais, plus libres.