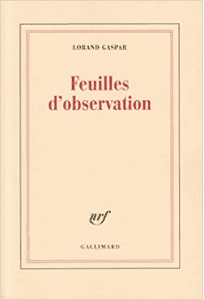
Cherchant une épigraphe pour un nouveau livre, je tombe sur une phrase de Lorand Gaspar dans Feuilles d’observation (1986), qui a tout pour me plaire: “Ce que tu ne peux taire ni par les mots ni par le silence”. L’énoncé dit parfaitement la condition sine qua non de toute écriture digne de ce nom: la nécessité (on peut rappeler que Gaspar a travaillé toute sa vie comme chirurgien, à Tunis dans ces années-là, et que son temps d’écriture devait être gagné sur des contraintes professionnelles souvent très dures). Quant à la forme grammaticale de la phrase, elle implique tout de suite l’allié non moins indispensable de cette écriture: le lecteur, ici promu en auteur. La citation évoque aussi le travail de l’écriture, qui plus est par un joli paradoxe. Enfin, la phrase même joue d’un statut équivoque, entre texte et hors-texte: paragraphe initial de chapitre et suivie d’un blanc généreux, elle se détache en quasi-exergue en haut de la page.
Dans la section suivante du livre, quelque cinquante pages plus loin, au milieu d’une page et serti entre deux pavés de texte plus consistants, apparaît un court poème:
Je ne peux le taire
ni par les mots
ni par le silence –
C’est le seul de son genre dans ce recueil qui pourtant insère avec fréquence des poèmes au cours de ses méditations: il est en italiques alors que tous les autres sont en romains et il est aussi le seul à revenir presque littéralement sur une réflexion déjà formulée. Mais la reprise est décevante. Non pas en raison de la répétition: la gageure, largement tenue, de Feuilles d’observation est de creuser sans cesse un jeu réduit de thèmes et d’idées (la lumière, la fragilité de l’être, l’étonnement face au monde, la beauté, notamment). Ce qui gêne, c’est la perte causée par l’intention littéraire. L’italique, le passage à la ligne, le tiret de la fin suggérant quelque “etc.” Inépuisable, soulignent l’importance d’une pensée qui n’a nul besoin de ces béquilles. Le retour à la première personne du singulier crée une distance entre auteur et lecteur, mainmise tardive du je du poète sur un énoncé d’abord attribué, c’est-à-dire offert, au lecteur. Le remplacement du pronom “le”, noyé en milieu de vers, par l’initial démonstratif “ce que” banalise l’idée de Gaqpar par un flou artistique, par un vague effet de récapitualation diluant l’attaque, au sens musical du terme, de la phrase en prose. Enfin, la position du poème au centre de la page, entre deux fragments en prose, en fait une manière de pièce détachée, inutilement mise en abyme, alors que la première occurrence de la même idée entretenait une subtile confusion entre texte et exergue.
Mésabventure minuscule, sans doute. Mais qui ne va pas sans morale: la poésie risque d’être fausse, et partant impuissante, si elle en rajoute. Pour être poésie, il suffit que le texte soit juste –et nécessaire, bien entendu.
Jan Baetens