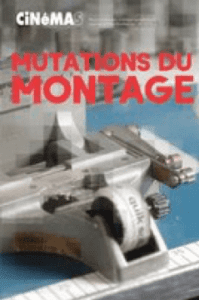
Lorsque nous avons commencé à regarder les films sur le petit écran, Jean-Luc Godard a résumé la différence par une célèbre boutade, diversement commentée depuis: « Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. » À l’instant de passer aux cassettes, puis aux DVD, d’autres ajustements sont devenus nécessaires, pour expliquer par exemple que le cinéma avait intégré ce qui avait toujours paru aux antipodes de son essence, comme la possibilité offerte au spectateur de faire des arrêts sur image et de manipuler la vitesse de défilement des signaux optiques. Aujourd’hui, avec la diffusion des films sur le net, les bouleversements sont plus radicaux encore et c’est sur l’un d’eux que se penche Martin Bonnard, qui prépare à Montréal une thèse sur les catalogues cinéphiles de vidéo par abonnement. Le plus récent de ses articles « (Re)monter le cinéma sur le web », analyse la manière dont les films qui circulent sur la Toile, notamment via YouTube, se voient réunis dans des ensembles plus vastes et la manière dont ces nouveaux assemblages transforment notre idée du cinéma.
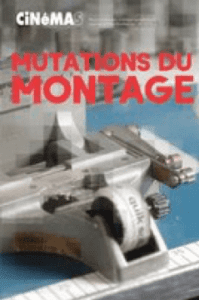
Bonnard attire l’attention sur trois phénomènes. D’abord la fragmentation des films, qui sur la Toile sont souvent réduits à des morceaux choisis, mais sans qu’on sache comment et pourquoi la sélection a été faite. Pour certains, dont Jacques Aumont, l’absence de toute « intention » explicite interdit la notion de montage, sans laquelle il est difficile de penser le cinéma : parler de montage face à des assemblages qui se font « comme ça » n’a plus guère de sens. Ensuite le rôle de la machine et des algorithmes de recommandation, dont tout le monde sait qu’ils sont déterminants au moment de passer d’un (bout de) film à l’autre et dont la logique, complexe car faite de l’interaction entre éléments humains et éléments machiniques, échappe à l’analyse du spectateur. Enfin, la possibilité de s’appuyer sur les nouvelles possibilités d’agencement des œuvres pour réfléchir à nouveau sur les formes et les fonctions du montage même, par exemple à travers le concept de montage à contrepoint (Artavazd Pelechian), qui « au lieu de juxtaposer deux plans côte à côte (…) préfère les séparer par plusieurs autres plans et augmenter ainsi la distance entre eux. Les fragments placés dans l’intervalle deviennent autant d’intermédiaires aptes à soutenir la réflexion du spectateur » (Bonnard, art. cité, p. 104).
Les analyses de Bonnard ne sont pas sans éclairer certaines métamorphoses dans le monde des livres, où des phénomènes analogues se produisent à cause de la transformation des imprimés en fichiers numériques. Ici aussi, le démembrement du texte est devenu un fait (les revues et ouvrages collectifs se vendent maintenant article par article ou chapitre par chapitre), avec tout ce que cela implique pour l’acte de lire, lui aussi de plus en plus rétif au déchiffrement « lent » (il y a tant d’autres messages qui nous tirent par la manche) et surtout « complet » (nous lisons des bouts, comme si le bout était censé être le modèle réduit du tout – illusion déjà violemment combattue par Adorno, qui voyait dans l’identification de la partie à l’ensemble le signe d’une mutilation de la culture). On retrouve là une des leçons de Lindsay Waters, directeur des Presses Universitaires de Harvard, dans un petit livre prémonitoire – et tout sauf aveugle pour les problèmes de l’édition traditionnelle– sur le déficit de certaines formes de démocratisation : L’Éclipse du savoir (éd. Allia, 2008 ; première édition américaine en 2004). Selon Waters, faute d’accéder à la totalité d’une argumentation, on s’interdit d’engager un dialogue critique avec elle et on renonce à ce qui est au cœur du débat intellectuel et démocratique, fait d’échanges informés.

Depuis, l’évolution du commerce des « contenus » sur le net, qui dépouille les livres de leur dispositif éditorial (on ne sait plus à quelle collection appartient un texte, on perd de vue le catalogue de l’éditeur qui lui donne une partie de son sens, on n’a plus la possibilité de voir la couverture et dans bien des cas l’appareil paratextuel qui l’accompagne, on ne sait plus à quoi ressemble l’objet même : son poids, son papier, sa main), montre que l’impact de la culture digitale ne peut se réduire au seul problème de la fragmentation. Comme dans le domaine du cinéma, les logarithmes guident nos pas dans nos déambulations d’un livre à l’autre. Une des grandes joies de la vie en bibliothèque, la sérendipité, n’a certes pas disparu, mais elle se voit sérieusement concurrencée par les suggestions ciblées d’Amazon, entre autres.
Mais revenons au troisième point que soulève Bonnard : la possibilité de réfléchir au comment et pourquoi du montage non plus à l’intérieur des œuvres (« dé-montées », car irrémédiablement vouées au morcellement) mais au niveau des liens d’une œuvre à l’autre. Il s’ouvre là de nouvelles possibilités de « re-montage », qui touchent à la fonction productrice des mutations technologiques. Trop souvent encore, nous subissons ces nouveaux agencements imposés du dehors, mais ce ne doit pas être une fatalité. L’éditeur aussi bien que le libraire, le critique, le bibliothécaire, l’anthologiste, le lecteur ont toujours été confrontés au défi, éternellement passionnant, des choix à faire. À l’ère numérique, cette question se complique encore, mais peut-être pour le plus grand bonheur de tous : il n’est plus suffisant de faire des choix, encore et surtout faut-il chercher à construire la logique qui permet d’organiser des parcours et des correspondances à l’intérieur d’un territoire virtuellement sans limites mais toujours en manque de repères internes.
Jan Baetens